|
Kader Belarbi, chorégraphe, Etoile du Ballet de l'Opéra National de Paris
27 janvier 2010 : à la rencontre de Kader Belarbi
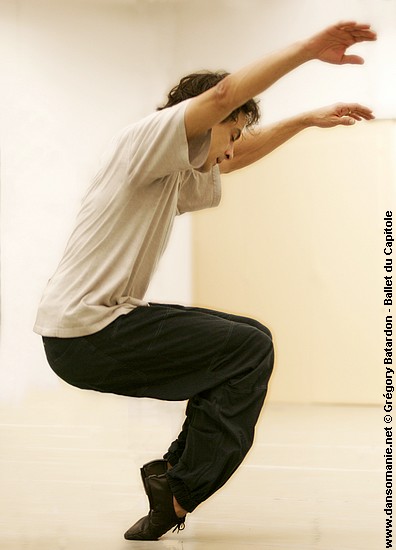
Comment concevez-vous votre rôle de chorégraphe?
J’ai attendu très longtemps avant de
décider de me considérer comme chorégraphe. Je
peux le dater très précisément de 1998. Je
considère les expériences qui avaient
précédé comme des essais chorégraphiques
qui prolongeaient mon activité de danseur, même si
certains, comme par exemple Le Bol est rond, un ballet humoristique pour 14 danseurs, ou bien Giselle et Willy, avaient très bien marché.
En 1998, j’ai eu l’opportunité de créer une
production entière au Japon, sur le thème de Picasso et
la danse. Je m’inspire d’ailleurs toujours de la peinture
pour mes chorégraphies. A cette occasion je présentais
Icare de Serge Lifar, dont c’était la création au
Japon, Le Rendez-vous de Roland Petit, que je dansais avec Fanny
Gaïda, puis L’après-midi d’un Faune de
Nijinski, pour lequel je mettais en regard le rideau
d’avant-scène de Picasso avec celui de Bakst. Pour la
quatrième pièce du programme, Les Saltimbanques,
je m’étais inspiré du tableau de Picasso
«Famille de saltimbanques», ainsi que d’une des Elégies de Duino,
de Rilke, qui évoque précisément ce tableau.
J’ai cherché à faire une évocation
poétique des personnages à partir de différentes
études de Picasso sur le monde du cirque. La musique
était jouée à l’accordéon
associé à un sampler. Il y avait aussi des bruitages avec
des ustensiles de cuisine. Les danseurs étaient de plusieurs
générations : Michaël Denard, Cyril Atanassoff,
Claire-Marie Osta, Eleonora Abbagnato, Jérémie
Bélingard.
Le retour était très favorable et je me suis dit que je
pouvais peut-être prétendre être chorégraphe.
J’essaie de rechercher une écriture véritable,
d’être un écrivain chorégraphique, de
distinguer d’un côté le corps et les
expériences, de l’autre l’écriture et le
mouvement, même si ces entités peuvent parfois
s’entremêler ou converger. C’est ensuite que
j’ai fait en 2001 Liens de table
pour le Ballet du Rhin, mais qui pour moi, par manque de temps,
n’était pas complètement abouti. C’est
pourquoi je présente une re-création à Toulouse.
Les Français connaissent Hurlevent, mais j’ai fait aussi la Bête et la Belle au Canada, Entrelacs en Chine, le Mandarin merveilleux
à Genève. J’ai eu un très bon dialogue avec
Brigitte Lefèvre pour pouvoir mener de front ma carrière
de danseur et mon activité de chorégraphe, en respectant
les différentes propositions que je recevais.
Je suis totalement ouvert aux propositions et pour chaque pièce
que je crée, la démarche est différente.
J’utilise le vocabulaire classique, mais avec une
sensibilité contemporaine sur les corps et l'actualité
d'aujourd'hui. Je travaille la ligne, le mouvement, avec de la
technique issue du classique.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le spectacle que vous présentez à Toulouse?
Tout est parti d’une proposition de La
Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne,
d’être artiste associé sur deux saisons, 2009/2010
et 2010/2011. J’ai trouvé intéressant de travailler
sur une durée, plutôt qu’une seule création.
J’ai pu rencontrer un théâtre, une équipe et
un public.
Pour la première saison, j’ai proposé de travailler
sur trois axes : une soirée classique, une soirée
contemporaine, et un atelier chorégraphique qui s’appelle
« Osons danser ». Je tiens beaucoup à la
cohérence de cet ensemble.
La soirée classique est en partenariat avec le Ballet du
Capitole car c’était le souhait de Frédéric
Chambert, le directeur artistique du Théâtre. Les danseurs
du Capitole iront donc à Châlons, mais la création
se fait à Toulouse. Frédéric Chambert a
souhaité que le titre de cette pièce en création, A nos amours
soit aussi le titre du spectacle. Il rappelle le thème du lien
qui est le thème de la saison entière à La
Comète.
Dans Liens de table, il
s’agit du lien familial, symbolisé par la table du repas
dominical, qui peut déboucher sur une forme de cannibalisme.
J’ai imaginé ce ballet en écoutant un quatuor de
Chostakovitch, expressif et violent, qui m’a bouleversé.
Après la création, j’avais le sentiment de ne pas
être allé au bout de l’idée du ballet. Il me
semblait qu’il y avait une autre dynamique, un autre sens dans le
mouvement à trouver Je n’ai en revanche rien
changé à la structure d’ensemble. Mais j’ai
abordé certains mouvements ou personnages d’une autre
manière.
Pour A nos amours, c’est le lien conjugal. Je suis parti
d’un pas de deux, Entre d’eux, que j’avais
créé pour Marie-Agnès Gillot et Jiří
Bubeníček sur l’Elégie
de Fauré. Cela m’a donné l’envie
d’associer une même confrontation entre un homme et une
femme à trois âges différents. Un couple est
symboliquement représenté par trois couples. La musique
sera jouée à ma demande par un pianiste et un
violoncelliste de Toulouse. C’est très important pour moi
car la musique est un moteur essentiel dans la création pour
chercher les cohérences, les adéquations ou les
décalages. Le couple jeune évoluera sur Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt, le couple adulte sur Fauré, et le couple vieux sur la Sonate pour violoncelle de Kodály, puis l’interaction de ces trois couples sur l’Heure exquise de Reynaldo Hahn.
Pour moi l’instant capital de la création c’est
l’échange avec les danseurs dans un studio, c’est le
moment où on éveille l’esprit et le corps de
l’autre, à travers le geste, à travers un
mouvement. C’est comme un jeu d’orgue avec plein de niveaux
sur lesquels on peut jouer : technique, esthétique, humain,
jusqu’à l’âme quelquefois. Il y a plein de
choses qui sont dans l’imperceptible, dans le non-dit.
C’est un travail passionnant où il faut être ouvert
à la spontanéité, mais aussi prendre du recul pour
analyser, et créer avec la matière vivante que sont les
danseurs.
J’ai proposé aussi dans le cadre de cette thématique du lien de compléter le programme avec la Pavane du Maure,
que je n’ai jamais dansé à l’Opéra.
Ce ballet fait partie de l’histoire de la danse. Il est
écrit, stylé, élégant, d’une grande
sobriété pour exprimer des sentiments shakespeariens.
C’est un langage du corps mais ce n’est pas de
l’illustration du théâtre. C’est ce que
j’aime dans la danse : chercher à effacer, ou
décanter, le quotidien ou l’illustration pour faire
apparaître, transpirer, le simple mouvement qui donne un sens.
Martha Graham ou Mats Ek disent en ce sens «Le corps ne ment
pas». Il faut laisser apparaître le
«cœur» de la danse qui s’exprimera. C’est
un chemin à trouver. C’est celui que je recherche comme
chorégraphe.
C'est donc le programme classique que nous verrons à Toulouse?
Et en avril à la Comète il y aura la
production d’une soirée contemporaine, pour laquelle j'ai
réuni des danseurs contemporains. Je vais préparer la
création d’un pas de deux de Mats Ek, Tulip,
que je danserai avec mon épouse Laure Muret, sujet à
l’Opéra, j’en suis très heureux. Je ferai
aussi la reprise pour cette soirée d’un de mes anciens
ballets que j’ai donné à l’Opéra, Salle des pas perdus,
sur de la musique pour piano de Prokofiev, jouée par une
pianiste de l’Opéra. C’est très important que
la pianiste connaisse aussi la danse. Cette pièce est une sorte
de huis-clos à quatre personnages, des étrangers
l’un à l’autre qui se rencontrent et qui regardent
leur passé, symbolisé par leur valise. On est donc
toujours dans la thématique du lien. Je reprendrai aussi le duo Les Epousés sur l’ Adagietto
de Mahler, qui avait été créé par Wilfried
Romoli, Nicolas Le Riche et Norah Krief, sur le lien fraternel entre
Vincent et Théo van Gogh. Enfin une création, Room,
sur le thème des accessoires qui peuvent servir
d’intermédiaire entre deux personnes. J’utiliserai
des musiques de Pärt et de Gorecki.
La troisième partie de mon projet, «Osons danser»
est un atelier sur quatre jours, qui a eu lieu à Toulouse en
janvier, ouvert à tout le monde, de tous ages et de toutes
origines. Vient qui veut faire un acte dansé. J’ai choisi
de travailler le premier jour avec deux groupes. J’ai
incité les gens à rechercher à travers leur propre
histoire des gestes, des traces de danse, des mouvements, conduits par
quatre danseurs du Ballet du Capitole. Je souhaitais vraiment que des
professionnels viennent rencontrer des amateurs. J’étais
assisté de Jean-François Kessler, ancien maître de
ballet au grand théâtre de Genève. Mireille, la
responsable des ateliers travaille dans l’éducation
physique et pour la formation option danse du baccalauréat. Il
fallait mélanger tous ces regards-là pour conduire,
accompagner et amener les gens à coudre leur proposition. Le
premier jour était consacré au solo, au territoire
personnel. Le deuxième jour ils se rencontraient en duo,
toujours sur leur proposition. Une semaine après il y avait un
travail de mémoire. Et le quatrième jour les deux groupes
fusionnaient pour que chacun soit à l’écoute de
tout le monde. Ils ont pu faire un déroulé exact de plus
de 25 minutes de ce qu’ils avaient appris. C’était
formidable et très émouvant.
On n’a pas pu le faire à Toulouse par manque de salle
disponible mais mon intention était de pouvoir emmener ce
travail sur scène devant un public pour faire éprouver et
ressentir le processus chorégraphique, pour qu’ils
deviennent «transmetteurs» en agissant sur le public. A la
Comète ce sera possible. Les danseurs amateurs iront chercher
des volontaires parmi le public. C’est tout un processus
d’apprentissage, d’appropriation de la danse, pour devenir
aussi acteur sur le public. Plusieurs villes sont
intéressées pour reprendre cette expérience, mais
je souhaite qu’elle soit liée à la programmation,
soit au programme classique, soit au contemporain.
La conférence sur le thème proposé par
Frédéric Chambert : «Comment construire un ballet
aujourd’hui?» fait aussi partie de mon projet. Je souhaite
qu’il y ait également un débat, un échange
avec le public, donc encore un lien, de nature plus intellectuelle.
J’ai des contacts, en France et à l’étranger,
pour diffuser les deux spectacles, contemporain et classique, pour
prolonger la rencontre, et continuer à les faire vivre.
Vous avez évoqué vos inspirations liées à
la peinture, est-ce aussi le cas pour le spectacle de Toulouse?
Je pense que si je n’avais pas
été danseur, j’aurais été peintre.
J’essaie de faire une peinture par an quand j’ai le temps
de m’y consacrer à plein. J’ai été
épaulé dans cette voie par Monique Baroni, qui peint
à l’acrylique des couleurs sublimes et qui est
quelqu’un de très érudit dans le
procédé de peinture.
Chaque fois que je crée un ballet, j’y associe toujours un
peintre. C’est quelque chose qui intervient souvent en un
deuxième temps, que je découvre après. Par exemple
pour Hurlevent c’était Balthus, bien sûr Picasso pour Les Saltimbanques, Van Gogh mais aussi Bacon pour Les Epousés. Pour Liens de table,
j’ai été inspiré par une
rétrospective Rothko que j’ai vue à Bâle et
que j’ai trouvée merveilleuse pour la vibration et la
couleur. Pour A nos amours,
j'ai pensé à Magritte, non pour le surréalisme,
mais dans la scénographie, pour l’idée des
correspondances et de la mise à distance.
Quelle est votre opinion sur le Ballet du Capitole?
Ce sont d’excellents danseurs, très
réceptifs avec un véritable niveau technique, dans un
très bel académisme. Je tire mon chapeau à
Nanette Glushak et à Michel Rahn pour le travail et la tenue de
cette compagnie. Il y a vraiment une rigueur et une discipline
académique excellentes. Pour moi le plus important
c’était de partir de ce véhicule classique pour
revenir à la simple notion de vie et de naturel des corps
d’aujourd’hui, même à travers un travail
totalement académique. Je ne veux pas d'une mécanique
figée. C’était d’ailleurs la demande de
Frédéric Chambert et de Nanette Glushak d'emmener les
danseurs vers davantage de courbes, de rondeurs, et de ressenti.
Vous ne revendiquez donc aucune filiation.
Absolument pas. Je cherche mon élan
personnel. J’ai évidemment eu des influences, de par mon
vécu. Je préfère parler plutôt que d'une
écriture personnelle, d'une écriture «à
propos», en cohérence avec mon sujet, et les danseurs avec
lesquels j'échange, ce qui est primordial comme je l'ai dit. Si
je pensais d'emblée au résultat, je ferais un produit, et
je m'y refuse. A chacun d'aimer ou pas.
Kader Belarbi - Propos recueillis par Jean-Marc Jacquin
Entretien
réalisé le 27 janvier 2010 - Kader Belarbi © 2010,
Dansomanie
|
|



















